|
Exposé sur les évolutions d'une
exploitation apicole.
Il s'agit d'une nouvelle version d'un article paru dans l'excellente revue de l'ANERCEA : INFO REINES.
Avec l'aimable autorisation de l'auteur.
De
l’utilité de réorienter une exploitation
pour l’adapter
au
nouveau contexte apicole
Après 15 ans d’une première vie
professionnelle comme
menuisier notre apiculteur picto charentais cherche à se reconvertir
dans un
métier où il sera autonome. Fils de paysan, ornithologue, il est depuis
toujours passionné de nature. Il découvre l’apiculture avec un ami puis
entre à
Laval en 1986. Formation décisive tant par la qualité de l’enseignement
que
dispensent de grands connaisseurs de l’apiculture professionnelle, que
par les
visites marquantes (comme celle de l’exploitation de Joseph Houtin).
Les amitiés
nouées dans ce vivier porteur resteront sources d’échanges jamais
interrompus.
Après un stage, l’élevage de reines (sélection massale majoritaire) est
pratiqué dans le but exclusif de produire les cellules introduites dans
les
essaims. Production d’essaims, très marginale qui n’a d’autre but que
de
renforcer les ruches affaiblies par l’essaimage ou de remplacer les
disparues. L’achat
régulier de souches (noire ou caucasienne) pallie aux risques de
consanguinité.
La variété des miellées régulières et la persistance d’un biotope assez
riche
évite le recours aux produits de nourissement. Le travail à la ruche
est plutôt
intensif avant tout par goût. Les transhumances sont de faibles
ampleurs (50 km). Les investissements et les frais en général
sont limités au maximum. Pas de chaîne
d’extraction, pas de grue, le camion plateau acheté en 1995 est encore
opérationnel et un véhicule léger autant que rustique suffit aux
simples
visites. L’embauche de personnel temporaire et l’entraide sont des
occasions
d’échanges que ce travail en solitaire rend précieuses.
Parallèlement
il s’investit beaucoup dans l’éducation de ses enfants, construit en
partie une
nouvelle maison, transforme la première en gîte, édifie ses bâtiments
d’exploitation, fabrique évidemment toutes ses ruches. Et la famille
part même
en vacances en juin. On croit rêver ! Une époque révolue !
Après
quelques années de montée en puissance suivent quinze ans sans réels
problèmes
dans une zone de grande culture particulièrement propice à de forts
rendements
en l’absence de problèmes sanitaires notables. Il exploite seul une
moyenne de 370
ruches qui produiront jusqu’à 29 tonnes. Autant dire que l’urgence est
plus alors
à la pose de hausses qu’au remérage. 80% de la récolte est obtenue sur
le
tournesol auquel s’ajoute le colza et un peu de forêt... En inter
miellée
acacias, tilleuls, lotiers et ronces assurent la survie sans procurer
une
véritable récolte. 2008 et 2009 seront les dernières années de
productions
satisfaisantes.
A partir de cette date les résultats des
miellées évoluent de manière
totalement opposées. La récolte de colza égale, voire dépasse, celle du
tournesol et la moyenne chute de 20kg alors
que la charge de travail augmente
considérablement ; il faut maintenant traquer sans fin les ruches
« qui ne tournent pas ».
En 2010 l’épouse de notre
apiculteur revient sur l’exploitation
et pour un nombre de ruches en baisse régulière la main-d’œuvre double
et les
journées s’allongent. Même si les prix compensent la chute des
récoltes, il ne
saurait être question de vivre au passé.
Il est temps de s’ouvrir pour voir comment,
ailleurs, on fait face à la
situation. Ils adhérent à l’ANERCEA conscients de devoir maîtriser
parfaitement
l’élevage pour disposer en permanence de reines jeunes. Par ailleurs la
fatigue
devenant difficile à gérer, il est temps d’inventer un nouveau mode
d’exploitation. Et voilà comment à 60 et 55 ans on se retrouve dans la
peau de
jeunes débutants. L’objectif est d’adapter le cheptel à la force
(déclinante) de
travail disponible, de diminuer fortement le nombre de ruches pour se
stabiliser à 200 (2015), d’augmenter le nombre d’essaims pour en
développer un
peu la vente, de suivre d’encore plus près le cheptel jusqu’à bannir
les non
valeurs toujours sans recours au nourrissement qui entraine surcroît de
travail
et frais.
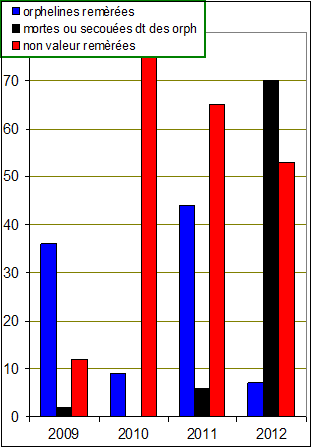
Après avoir fait le constat d’une
nécessaire réorientation, la décision a été prise de revoir totalement
le mode
d’exploitation.
Premier
outil mis en place : les nucs.
L’objectif
est de parvenir à renouveler environ la moitié des reines chaque année
sans
trop pénaliser la production. Durant les 3 dernières années le couple
apprend à
maitriser la technique et augmente progressivement le nombre de nucs
pour
atteindre les 80 à 90 nucs qui permettront le remérage d’un nombre égal
de
ruches en partie à la visite d’automne puis à l’issue de la visite de
printemps. Les reines produites de mai à
juin devant si possible être réservées aux
essaims dont le nombre augmente aussi
régulièrement. En 2012, une
cinquantaine de haussettes sont montées sur plateau
amovibles. Elles sont peuplées à partir des meilleures ruches conduites
à
pondre en hausse. Après ce premier été de tâtonnements, 10 reines
buckfast sont
achetées en septembre à Sophie Dugué. Elles seront les populations
magasins
destinées à peupler et renforcer les nucs tout au long de la saison. Le
greffage s’opère sur la ponte de reines inséminées caucasiennes ou
noires. Pour
poursuivre sans nourrissement il faut rester sur des ruches point trop
gourmandes et aptes à constituer leurs provisions. Les fécondations
sont
totalement incontrôlées ce qui est bien évidemment peu satisfaisant. En 2013, 60 nucs sont en activité (10 mini
plus, 50 haussettes). Les premières cellules sont introduites
tardivement (10
mai) et les dernières à la mi juillet. Les nucs les plus longtemps en
activité
ont produit 3 reines mais ils restent trop rares. Une vingtaine de
reines sont
introduites en septembre dans les colonies affaiblies après tournesol.
Les nucs
sont ensuite regroupés deux à deux avec une reine buckfast achetée
cette fois à
Laurent Dugué.
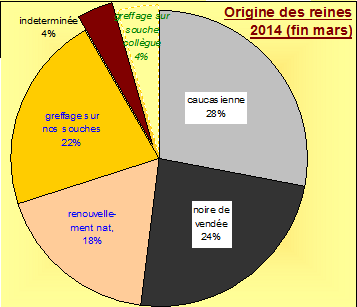 
En
2014 les premières introductions de cellules dans les nucs datent du 19
avril
(grand progrès auquel la météo n’est pas étrangère), pour des reines
mises en
ruches du 20 mai au 26 juin (trop tard). Le nombre de nucs est de 80
dont 30
mini plus sur cadre hoffman. Ceux qui ont reçu les premières cellules
ont élevé
jusqu’à 4 reines. Le taux de reines prélevés par rapport aux cellules
introduites avoisine 70%.
Ces reines (marquées clippées) sont
introduites de la manière suivante.
Elles sont enfermées dans une cage d’expédition Nicot avec quelques
suivantes.
Le bouchon de candi est obturé. La
cagette est posée sur les têtes de cadres et laissée au bon soin de la
colonie
dont la reine a été tuée. Si elle est introuvable (reine vierge
possible) la
colonie a été secouée au loin. On repasse après 48h pour ôter le scotch
et la
reine est alors libérée par les abeilles. Utilisée auparavant la grille
sur
couvain naissant donnait un taux
d’introduction réussi de 82%. Avec la cagette les 100% sont approchés
avec
moins de temps de travail.
La
production de cellules s’arrête à la fin juillet où le
taux de réussite faiblit faute de mâles. En début de saison des cadres à mâles ont été
placés dans de bonnes ruches (bien noires) auprès des nucs,
mais l’effort n’a pas été poursuivi
toute la saison. C’est là notamment que des marges de progrès restent à
trouver.
Au
printemps 2014 seules quelques reines caucasiennes ou noires étaient
disponibles pour les premiers remérages. En 2015, 30
reines caucasiennes hivernées dans les nucs
réunis 2 à 2 seront disponibles dès les premiers élevages. Les reines
des 30
nucs orphelinés ont été données aux colonies lors de la visite
d’automne. 15 « magasins » en
buckfast
hivernent et serviront au printemps à repeupler les nucs divisés. Mais
l’objectif était plus ambitieux, la fin de saison du tournesol a été
difficile
car la miellée était faible et irrégulière et certains nucs se sont
affaiblis. Là
aussi il conviendra d’être plus vigilant en 2015. En novembre néanmoins
il
semble que dans certains ruchers les moutardes d’inter culture aient
relancé le
dynamisme mais il ne faudrait pas que la douceur se prolonge trop
longtemps car
le recours systématique au candi deviendrait impératif.
Les essaims :
La
production d’essaims a donc été longtemps marginale avec un fort taux
d’échec,
faute de suivi suffisant. Ce printemps, 50 essaims dotés de 4 ou 5
cadres de
couvain et de fortes populations ont été vendus. Les acheteurs les ont
rapidement redivisés ou enruchés et ont obtenu du miel sur colza. Ces
essaims sont
constitués en fin de miellée de colza sur 2 ou 3 cadres de couvain.
Deux
méthodes sont utilisées : le prélèvement de couvain en s’assurant
à l’œil de
la non présence de la reine (marquée donc plus facilement visible) ou
la pose
d’une ruchette sans fond.
Cette
méthode requière de revenir le lendemain matin mais assure un meilleur
équilibrage des populations et évite à tout coup la prise accidentelle
de la
reine. Deux ou trois cadres de couvain sont secoués sur la ruche et
posés dans
la ruchette sans fond entourés d’un cadre de miel et d’une ou deux
gaufres. La
ruchette est centrée sur les cadres de couvain restant dans la ruche au dessus d’une grille à reine, son
couvre cadre obture l’emplacement découvert. Le lendemain matin de
bonne heure,
la ruchette est reposée sur son plateau, bouchée et emmenée puis elle
reçoit une
cellule protégée par un film aluminium. Tout échec (reine non née,
ponte non
satisfaisante) conduit à l’apport de couvain et d’une reine plutôt que
d’une
nouvelle cellule afin de rattraper son retard.
160
essaims ont été ainsi constitués du 16 au 30 avril sur 65% des ruches.
Ils ont
saturé les corps en tournesol et ont produit une moyenne de 5kg de
tournesol à
la ruchette. Début juin le travail sur le remérage des ruches étant
presque
achevé, les meilleurs essaims ont été amputés de 2 cadres (par la méthode des ruchettes sans plateau) et
une reine marquée clippée leur a été confiée. Ces derniers
essaims se sont bien développés mais certains
ont ensuite marqué un temps de souffrance en août faute d’une
population suffisante
pour exploiter la timide fin de miellée du tournesol. Il aurait sans
doute
fallu palier à leur souffrance par un nourrissement dès la fin juillet.
Ils ont
été nourri au miel en septembre, nous saurons cet hiver si cette
période de
souffrance leur aura ou non été néfaste. Mi juillet un contrôle de tous
les
essaims a entrainé une dizaine de remérages. Le bilan est donc le
suivant :
83%
des essaims réalisés sur la saison sont en hivernage soit en ruchettes
soit en
ruches pour les plus beaux.
Tout cela pour quoi :
Voyons
maintenant l’intérêt de tant de travail. Il faut bien avouer que la chute régulière de la moyenne de
production à la ruche nous fait douter de l’intérêt pour nos lecteurs
du récit
de notre expérience. Car enfin depuis 2010 diminuer le cheptel de 30%,
augmenter la main d’œuvre, investir même modestement pour produire
toujours
moins, voilà qui est peu exemplaire. Pour déceler des progrès nous
avons
replongé dans nos données car toute visite de ruche engendre des notes
reprises
sur un tableau Excel. Nous avons ressorti les données brutes et tenté
d’en
tirer quelques enseignements dont voici les conclusions :
Jusqu’en
2013, aux mortes de l’hiver venaient périodiquement s’ajouter des
ruches
secouées durant la saison, il était rare de descendre en dessous des
13% de
mortes en hiver auxquelles venaient s’ajouter 10% au moins de ruches
secouées
en saison et à l’automne. En 2014, 2 ruches bourdonneuses seulement ont
été
éliminées en saison et celles qui ont été démontées à l’automne avaient
donné
du miel et même parfois beaucoup. Si on ajoute les pertes de l’hiver
2013-2014
au taux de démontage de l’automne ont est à moins de 14% . L’objectif est aussi de traquer les non valeurs,
le bilan en ce domaine est éloquent. En 2013 encore 33% des ruches
avait
produit moins d’une hausse. En 2014, 2% seulement des ruches sont dans
ce cas
et aucune n’a rien produit du tout. On constate un resserrement des
écarts à la
moyenne (moyenne au rucher bien entendu). Moins d’exception et presque
plus de
non valeurs. En 2015 avec 200 ruches tout incident devrait en théorie
être
résolu avant que la colonie ne flanche véritablement. Mais attention il
reste
la problématique varroa, invaincu, et les hypothèques engendrées par le
réchauffement climatique qui pour ce que nous en voyons ces temps ci se
traduit
par une activité quasi incessante fortement dommageable aux provisions
hivernales.
Reste
bien des questions à résoudre qui font qu’une nouvelle vie d’apiculteur
serait
nécessaire d’autant que nous n’avons pas
eu à nous les poser durant la plus grande partie de notre carrière. Il
nous
faut d’abord mieux maîtriser la connaissance de la génétique ce qui
pour de
purs littéraires n’est pas une mince affaire.
Voici
en vrac les points qui nous interrogent le plus : comment dans un
secteur
ouvert et fortement fréquenté par les apiculteurs s’assurer d’un
maximum de
fécondations par des mâles de race noire plutôt que buckfast ?
Quels sont
réellement les avantages du clippage pratiqué depuis deux ans avec des
résultats très différents. La saison 2013 était assez peu favorable à
l’essaimage et il n’y a pratiquement pas eu à en déplorer. Cette année,
clippées ou non, les reines ne sont pas toujours présentes à l’appel.
Néanmoins
le pourcentage des colonies dotées d’une reine non introduite n’est que
de 18%
et bien souvent la reine élevée l’a été sur le couvain d’une reine
introduite
qui a sans doute été refusée après ponte c’est-à-dire sans départ d’un
essaim.
Autre
question que celle des souches, les éleveurs de caucasiennes ne sont
pas
légion. Satisfaits de notre vendeur actuel nous nous inquiétons de
possibles
consanguinités. A partir de quel moment faire entrer du sang
neuf ?
Enfin
l’année assez atypique que fut 2014 amène
à réfléchir sur l’intérêt d’avoir beaucoup, voire trop de couvain,
quand la
miellée s’étire et est peu virulente et quand l’inter saison se fait
longue.
Les brusques écarts de température connus ce printemps nous amèneront
cet hiver
à fabriquer quelques unes des partitions chaudes vantées par Marc
Guillemin. Et
voilà encore des expériences à tenter en espérant que le jour reviendra
où
elles seront récompensées.
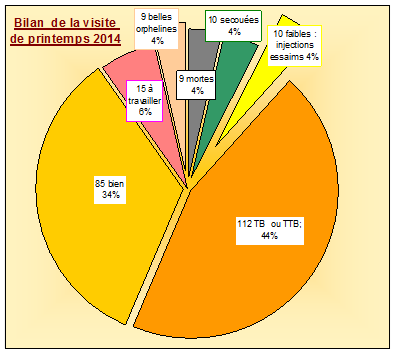 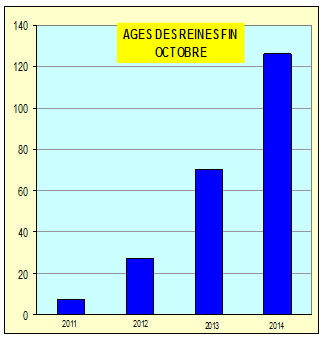
56
essaims 2013 ont été réunis à des non
valeurs en mars ou enruchées
25
essaims ont été injectés dans des ruches faibles après colza
73
reines marquées clippées ont été introduites dans les ruches de mai à
juillet
270
cellules royales ou reines ont été introduites dans des essaims
--------------------
Les ruches à reines
caucasiennes produisent 3.8 cadres de plus que la moyenne des ruches
Les ruches dont les reines
sont issues d’une sélection massale sont à hauteur de la moyenne
Les ruches dont les reines
sont issues de remérage naturel ou d’une souche d’abeilles noires
produisent 1
cadre de moins que la moyenne
|
 > petites
et grandes histoires > exposé introspectif d'une
exploitation apicole Picto Charentaise
> petites
et grandes histoires > exposé introspectif d'une
exploitation apicole Picto Charentaise